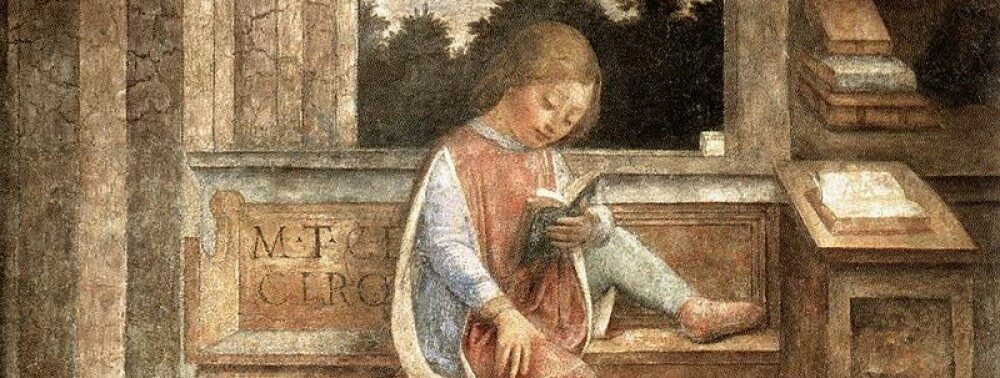Liste des colloques organisés en 2006 à propos du latin médiéval et du néo-latin.
– 3 mars 2006, Bordeaux : Journée Lire Aristote au Moyen Âge et à la Renaissance : réception du Traité sur la génération et la corruption, Université de Bordeaux III, organisée par J. Ducos et V. Giacomotto-Charra.
– 27-29 mars 2006, Limoges : Colloque La traduction des Anciens en Europe du Quattrocento à la Révolution, Université de Limoges, organisé par C. Lechevalier et L. Pradelle.
– Mai 2006, Verona : Colloque “Il segretario è come un angelo”: trattati, raccolte, epistolari, vite paradigmatiche o come essere un buon segretario nel Rinascimento, organisé par le Gruppo di Studio sul Cinquecento Francese.
– 27-29 mars 2006, Limoges : Traduire les Anciens (Grecs et Latins) en Europe du Quattrocento à la fin du 18e siècle :d’une renaissance à une révolution ?, Université de Limoges, org. C. Lechevalier (Université de Caen) et L. Pradelle (Université de Limoges).
– 6-13 août 2006, Budapest : Congrès International de l’IANLS : Varietas gentium- Communis Latinitas, org. Dr. Gyula Mayer et Prof. Dr. L. Szörényi.
– 4-8 septembre 2006, Oxford (Corpus Christi College): Colloque Erasmus and the Republic of Letters. Rens.: Stephen Ryle. Conference Announcement and Call for Papers: The conference will cover all aspects of Erasmus’ achievement and influence in the fields of education, literature, biblical studies, and theology. Keynote speakers include Lisa Jardine, J.K. McConica, Hilmar M. Pabel, Jane E. Phillips, Erika Rummel, and Mark Vessey. Proposals for papers of 20 or 30 minutes’ duration are invited. Abstracts of c.150 words should be sent by 31 December 2005.
– 22-23 sept. 2006, Paris (Paris IV-Sorbonne) : Colloque Le tyran et sa postérité. Rééflexions sur les figures du pouvoir absolu de l’Antiquité à la Renaissance, organisé par C. Lévy (U. de Paris IV, Equipe « Traditions romaines ») et L. Boulègue (U. de Lille 3, UMR « Savoirs, Textes, Langages »).
Présentation (résumé) : On aurait pu penser que les spécificités propres à la figure grecque du tyran la rendaient inexportable en milieu romain, la res publica ayant déjà son propre repoussoir, le rex. L’installation de la philosophie à Rome, la présence de penseurs comme Polybe ou Panétius allait, dès le second siècle av. J.C., avoir pour conséquence une osmose des catégories grecques et romaines du politique et une intellectualisation plus grande du mos maiorum. Cependant, c’est au Ier siècle av. J.C., et tout particulièrement avec Cicéron, que le tyran fait irruption dans la pensée politique romaine, comme moyen de penser une réalité dont le caractère chaotique apparaissait chaque jour avec plus d’évidence. Si César apparut à Cicéron comme l’incarnation romaine du tyran platonicien, l’habileté d’Auguste aboutit à l’apparition d’un Ianus bifrons, à la fois princeps héritier de l’idéal cicéronien, et tyran pour tous ceux qui vivaient dans la nostalgie de la res publica. La philosophie politique romaine à l’époque impériale se construira donc en fonction des multiples manières de penser la triade: république/prince/tyran. L’analyse diachronique des concepts de principat et de tyrannie, fondée sur l’étude de textes d’inspirations très diverses, devrait permettre une perception plus juste de la dette de Rome à l’égard de la pensée politique grecque et de l’apport spécifiquement romain à la pensée politique occidentale. Le débat sur les figures du prince et du tyran se poursuit dans les traités politiques des humanistes avec, souvent, un souci éthique très fort, du moins jusqu’au début du XVIe siècle. Ces écrits adoptent plusieurs formes et aussi se jouer des limites de tel ou tel genre, et les nombreux traités de cour, qui fleurissent au cours du XVIe siècle, peuvent être considérés comme de nouveaux types de traités politiques. Comment pose-t-on encore la question des trois grands types de régimes politiques et que devient la figure du tyran dans un contexte historique, politique et religieux radicalement différent de celui des sources antiques ?
– 22-23 septembre 2006, Perth : Colloque Humanism and Medicine in the Early Modern Era, Institute of Advanced Studies, University of Western Australia, Perth, oraganisé par Professor Yasmin Haskell and Dr Susan Broomhall.
Présentation : The symposium will explore the complex, and sometimes troubled, relationship between humanism and medicine from the fourteenth through eighteenth centuries. The father of humanism, Francesco Petrarca, famously attacked the medical profession in Against the Doctors (1352). Humanism spoke a new language theoretically a natural, classical Latin, as opposed to the ‘barbaric’ scholastic idiom of the philosophers and the Galenist gobbledygook of the doctors. But the cultures of humanism and medicine inevitably enriched one another: doctors and humanists shared a professional interest in the ancient texts (from Dioscorides to Lucretius), and a vested interest in preserving Latin as a professional argot. Humanism had its own healing pretensions through poetry and moral philosophy. In the sixteenth and seventeenth centuries, doctor and humanist sometimes co-existed in the same person such as Girolamo Fracastoro, Girolamo Cardano, Julius Caesar Scaliger, François Rabelais, and Pierre Petit.
Appel à communication: Papers (30 minutes) should consider various aspects of this road theme, including but not limited to the interface between learned and non-learned medicine, vernacular humanism and medicine, the evolution of the identity of the humanist physician over the early modern era, and the extent to which a consciousness of ‘two cultures’ prevailed in different local and institutional contexts. Please send a 300-word abstract before 1 December 2005 to the conference organisers.
– Sept.-oct. 2006 (proposition de date provisoire), Lyon : Colloque international Commencer et finir, La notion de début et de fin dans les littératures grecque, latine, byzantine et néolatine, organisé par le Centre d’Études et de Recherches sur l’Occident Romain (CEROR, EA 466) et le département de Lettres Classiques de l’Université Jean-Moulin-Lyon III. Organisateurs scientifiques : Christian Nicolas et Bruno Bureau.
Présentation : Prendre en compte la problématique du début et de la fin est une constante de la topique rhétorique : les noms pour désigner ces notions sont multiples, témoignant de la complexité du phénomène d’ouverture et de fermeture d’une oeuvre ou de ses parties. Commencer et finir peut en effet s’appliquer à une oeuvre, voire un ensemble d’oeuvres (recueil), une partie topique d’oeuvre (récit enchâssé, discours, digression, ekphrasis), voire une structure narratologique ou dramatique (notions d’exposition, de dénouement, d’exorde et péroraison etc.), impliquant parfois un débordement de la structure par la matière même de ce qui est dit (analepse, prolepse, dans le cas de prophéties, retours en arrière etc.). Où finit le début, où commence la fin devient alors une question pertinente. Se pose aussi la question de l’autonomie du texte par rapport à des éléments qui l’entourent : insertion de textes dans des recueils et notion même de début et fin de recueil, paratexte (préfaces et postfaces, dédicaces et texte d’envoi, prologues et épilogues) qui compliquent la perception des « vrais » débuts et fins du texte lui-même, quand ils ne l’occultent pas (présence d’un paratexte rapporté, par un éditeur ou un scribe par exemple).
Peut-on enfin retracer une histoire du début et de la fin en littérature de la Grèce archaïque à la Renaissance, quels sont le sens et la portée des évolutions en particulier sur la notion même de texte ou d’oeuvre (pensée du recueil, etc.…) ? La mise en perspective diachronique, comme le changement d’ère culturelle, peuvent conduire à retracer finalement quelques aspects d’une histoire du Texte.
– 23-25 nov. 2006, Clermont-Ferrand : Colloque international Présence du roman grec et latin, organisé par le Centre de recherches André Piganiol et le Centre de Recherches sur les Civilisations Antiques (CRCA) de l’Université de Clermont-Ferrand II. Rens.: Rémy Poignault.
Présentation : Les axes principaux proposés pour ce colloque sont les suivants, sans être exclusifs:
* les formes du genre : rapports avec la satire, l’épopée, le mime, la comédie, la tragédie, les récits de voyage, la fable milésienne, l’élégie érotique alexandrine, l’histoire, la rhétorique, la littérature orales.
* le monde du roman et sa topique
* la réception du roman grec et latin : sa transmission, sa redécouverte, traductions et éditions, son influence sur le roman byzantin, dans la littérature du Moyen Âge jusqu’à nos jours, mais aussi dans la musique, les arts figurés, le cinéma. Dans la tradition de pluridisciplinarité des travaux du Centre de recherches André Piganiol, on attend des contributions de spécialistes venant de différents horizons universitaires.
– 15-16 décembre 2006, Bruxelles (B) : Journées d’études sur les instruments de travail des humanistes Langue, livres, Livre, Musée de la Maison d’Erasme.
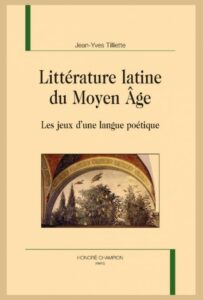 Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, le 28 mai 2024, aux éditions Honoré Champion, d’un ouvrage de Jean-Yves Tilliette, Littérature latine du Moyen Âge. Les jeux d’une langue poétique, dans la collection « Essais sur le Moyen Âge ».
Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, le 28 mai 2024, aux éditions Honoré Champion, d’un ouvrage de Jean-Yves Tilliette, Littérature latine du Moyen Âge. Les jeux d’une langue poétique, dans la collection « Essais sur le Moyen Âge ».